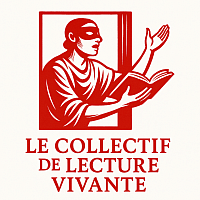EN VRAC
CHARLES DICKENS ET SES SPECTACLES DE LECTURE
1. Contexte et origine des « Public Readings »
Charles Dickens, déjà écrivain majeur de l’ère victorienne, engage à partir de la fin des années 1850 une démarche inédite : il ne se contente plus d’être l’auteur des romans, il se met en scène lui-même pour présenter ses œuvres au public. On parle des public readings (lectures publiques) qu’il donne, où il prend la parole, lit, improvise et incarne les personnages.
L’idée est à la fois simple et puissante : porter la force narrative et dramatique des romans dans un espace vivant, où l’auditoire est confronté à la voix et à la présence de l’auteur-interprète. Selon Susan L. Ferguson : « performances in which he took up his own novels before audiences … and brought the characters to life through his impersonation of them, invented a new genre of performance. »
Cela signifie que Dickens anticipait l’idée d’une fusion auteur-acteur, lecteur-spectateur. Il redéfinit le rôle de l’écrivain, non seulement comme créateur de texte, mais comme médiateur vivant du récit.
2. Modalités et déroulement des lectures
a) Le style de la mise en scène
Dickens privilégie une mise en scène volontairement minimaliste : pas de costumes élaborés, très peu voire pas de décors, un seul homme sur scène, parfois simplement un lutrin (lectern) ou un pupitre, le texte et la voix.
Cette sobriété scénique vise à placer l’attention sur le verbe, sur l’oralité, sur la présence. Le corps de Dickens – son geste, sa voix – devient l’instrument dramatique. Parmi les détails intéressants : dans l’un de ses reading tours, il avait un « leggio » (pupitre) conçu par lui-même, revêtu d’un drap rouge pour mieux souligner sa silhouette.
b) Le public et les espaces
Les lectures ont lieu dans des salles de concert ou de théâtre, parfois dans des villes de province (Angleterre), parfois à Londres, et plus tard lors de tournées. Par exemple : le 24 mai 1866, Dickens revient à Portsmouth pour deux soirées de lecture à la St George’s Hall.
Lors de sa grande tournée d’adieux (Farewell Tour) débutant le 6 octobre 1868 à Londres, il prévoit pas moins de 100 lectures à raison de plusieurs par semaine.
Cela signifie que l’événement n’est pas anecdotique : c’est un spectacle populaire, un moment collectif, où l’auditoire reçoit l’écrivain-acteur.
c) Le choix des textes et l’adaptation
Dickens ne lit pas ses romans intégralement : il les adapte, les coupe, les restructure pour l’effet scénique. Par exemple, pour A Christmas Carol (Publié 1843), la première lecture publique a lieu à Birmingham le 27 décembre 1853 ; par la suite il retravaille le texte pour le public des lectures.
Dans l’édition italienne d’un recueil de ses lectures publiques, on lit que de nombreuses parties descriptives sont supprimées ou réduites, et que le texte est profondément modifié pour l’efficacité dramatique.
Ce qui montre que Dickens opère un passage de l’écrit au spectacle : il transforme un roman en événement oral.
3. Intérêt et portée de l’entreprise
a) Sur le plan littéraire
Les lectures publiques permettent à Dickens de revisiter ses propres œuvres, d’en saisir de nouveaux angles et de les présenter autrement. Cela montre aussi que pour lui l’œuvre ne se « ferme » pas après publication : elle peut redevenir vivante, mouvante. Cela contribue à faire de l’écrivain-narrateur une figure publique, charismatique, quasi-acteur. Le panorama général est bien expliqué dans Collins : « Surprisingly little has been written about the Public Readings to which Dickens devoted so much of his time and energy. »
On y voit une redéfinition du « romaniste » : Dickens devient aussi «performer», et cela modifie la réception de son œuvre.
b) Sur le plan social et culturel
Ces lectures étaient des événements massifs et populaires : Dickens attira des foules, suscita de l’enthousiasme. À une époque où la lecture publique, la culture de masse se développent, Dickens fait figure de pionnier. À travers ses lectures, il engage également le public dans une réflexion sociale (pauvres, enfants, injustices) – même si l’adaptation scénique réduit parfois ces thèmes au profit de l’émotion littéraire pure.
Par exemple, dans la lecture de Sikes and Nancy (tirée de Oliver Twist), il accentue l’atmosphère sinistre et dramatique de Londres et de la bande de Fagin, ce qui provoquait des réactions intenses du public.
Ainsi, ces spectacles ne sont pas seulement divertissements : ils sont des actes culturels, des moments de communion autour du texte et de l’écriture.
c) Sur le plan personnel et biographique
Pour Dickens lui-même, ces tournées furent exigeantes : fatigues physiques, voyages, intense sollicitation de la voix et de la présence. Sa santé se détériora à la fin de sa vie ; sa dernière lecture publique eut lieu le 15 mars 1870 à la St James’s Hall, Londres.
On peut y voir un auteur qui, tout en poursuivant l’écriture, investit pleinement la scène, comme s’il voulait traduire en acte vivant ce qu’il avait conçu en écrit. Il prolonge sa relation avec le public.
4. Quelques jalons marquants
1853 : Première lecture publique de A Christmas Carol, à Birmingham (27 décembre).
24 mai 1866 : Lecture à Portsmouth ; retour dans sa ville natale pour une soirée de lecture très attendue.
6 octobre 1868 : Début de la grande tournée d’adieux («Farewell Readings») à Londres, à la St James’s Hall.
15 mars 1870 : Dernière lecture publique de Dickens, à la même salle.
5. Héritage et postérité
L’héritage des lectures de Dickens est multiple :
Le genre de «lecture publique d’auteur» devient plus courant. Dickens a contribué à légitimer cette forme de spectacle littéraire.
Ces épisodes ont inspiré des adaptations, des spectacles solo, des tournées littéraires modernes. Par exemple, une adaptation solo de A Christmas Carol par Patrick Stewart est souvent comparée aux lectures de Dickens.
En Italie, l’édition spéciale 2012 des «Letture teatrali di Charles Dickens» rend hommage à ces lectures publiques.
Sur un plan plus général, l’image de Dickens comme conteur, lecteur, comédien d’un soir, nourrit encore notre regard sur ce que peut être l’écriture vivante.